
Au premier abord, on n’imagine pas l’histoire de cet homme calme, aimable, rieur – et qui ne fait pas son âge. Puis on se rend compte que, si la forte personnalité de Michel Malonga s’est assagie avec les années, l’homme est un révolutionnaire iconoclaste qui ne moque de se faire des ennemis.
Né au Congo, étudiant en «chirurgie de guerre » à Cuba, médecin généraliste dans la brousse, ORL à Brazzaville, urgentiste en Normandie, et enfin ORL à la Pitié-Salpêtrière et à Sarcelles : itinéraire surprenant d’un homme, à la fois obstiné, optimiste et généreux.
« J’ai toujours été dans le mouvement ». Cette phrase, lancée spontanément dès le début de l’entretien, résume parfaitement la vie et la personnalité de Michel Malonga.
« Mon père était militant anti-colonialiste, ce qui lui a valu de faire de la prison. Sans doute ai-je été influencé… » Ce qui est certain, c’est que Michel Malonga, né dans le Sud du Congo-Brazzaville, débute sa scolarité avec quelque indiscipline : « j’ai fini par rattraper toutes les classes de la 5e à la 2de en cours du soir. Et au lycée, j’ai participé à des grèves ». Bref, un élève assez turbulent.

Michel Malonga enfant (2e en partant de la gauche) entouré de ses sœurs, son neveu et sa grand-mère.
 Etudiant à Cuba
Etudiant à Cuba
Turbulent, mais intelligent. En 1964, voulant former des cadres dans les pays pauvres, Che Guevara arrive dans une République du Congo fraîchement indépendante et nouvellement acquise au marxisme pour proposer à des lycéens de continuer leurs études à Cuba. Michel Malonga passe le concours et obtient une bourse. « Je suis parti à Cuba. La traversée durait 11 jours. Des B52 américains nous survolaient. Nous voyagions dans la soute du bateau, et nous avions la trouille ! C’était la guerre froide et la CIA a même annoncé que notre bateau avait coulé ! Mes parents croyaient que j’étais mort ! Nous avons dû nous prendre en photo et les envoyer à nos familles pour les rassurer. »
« J’ai eu mon bac scientifique à Cuba en 1966, avant d’y faire mes études de médecine, jusqu’à mon doctorat, option chirurgie. L’administration nous a donné une machine à écrire et – parce que j’étais alors le seul à savoir m’en servir – j’ai dû faire deux listes : une de ceux qui voulaient rentrer et une de ceux qui voulaient faire des études supérieures. »
Les trois-huit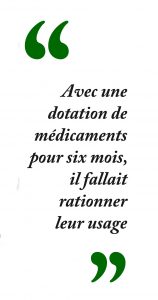
« Nous étions 2 500 étudiants à Cuba en première année de médecine, mais seulement 250 à la fin de nos études. J’ai toujours estimé que nous devions nous entraider entre étudiants congolais. Nous nous étions organisé pour qu’aucun d’entre nous ne redouble. Je relevais les notes des autres étudiants, pour les orienter au mieux, j’étais derrière eux, je les poussais lorsqu’ils ne travaillaient pas assez… J’avais mis en place un système de « sentinelles » : nous faisions quasiment les 3×8, nous ne dormions tous en même temps que de 5 à 8 h du matin. Puis nous faisions des révisions communes en fin de la semaine. Chacun approfondissait les matières dans lesquels il était le meilleur, et aidait les autres. Par exemple, comme j’étais bon en anatomie, je me suis concentrée sur cette matière. Je suis même devenu moniteur d’anatomie. Je dormais même dans le laboratoire de dissection anatomique. Mais on a fini par m’en chasser… », se souvient-il en riant.
Cela n’empêchait pas les vacances… « rythmées par les périodes de coupe de canne à sucre : on coupait la canne à sucre pour l’industrie sucrière de Cuba, pendant un mois environ chaque année. »
Et dans tout cela une constante : Michel Malonga s’est bien vite fait remarquer : « j’étais, disons, un peu agité ». « J’ai eu des ennuis avec l’ambassadeur du Congo : j’étais responsable culturel des étudiants congolais à Cuba. Je les défendais et demandais à l’ambassade de les soutenir plutôt que de les renvoyer à Brazzaville lorsqu’il y avait des problèmes. » A tel point qu’à la fin de ses études, « l’ambassadeur a voulu récupérer mon diplôme ! »
 Promotion « Che Guevara »
Promotion « Che Guevara »
Pendant ses études, Michel Malonga s’oriente vers la « chirurgie militaire ». « J’étais en stage en chirurgie lorsqu’un matin, on m’appelle et on me dit : « tu vas être l’assistant du chirurgien de Fidel Castro » ! C’était pour une opération de l’estomac, je m’en souviens très bien. Ce chirurgien m’a donné de bons conseils, et cela m’a incité faire mon internat en chirurgie dans une clinique militaire. C’était une école de rigueur. Il fallait reconnaître les instruments les yeux fermés et au bout de trois mois, savoir se débrouiller dans la brousse. J’ai beaucoup appris. J’étais le seul Congolais à faire cette spécialité. »
« J’aimais d’ailleurs beaucoup l’armée, mais mon épouse, que j’avais rencontrée pendant mes études et qui était pédiatre, m’a dissuadé d’y rester. Elle m’a probablement ainsi sauvé la vie. »
Finalement, en 1974, il sort diplômé de médecine, option chirurgie, avec une mention « excellent », promotion Che Guevara ! « J’ai prêté serment sur l’Ile des Pins, l’île de la jeunesse. Je voulais ensuite faire une spécialité en chirurgie cardio-vasculaire, mais l’ambassadeur – qui ne m’appréciait toujours pas – s’y est opposé et je n’ai pu faire ce cursus que de janvier à la fin du printemps. Puis il a fallu rentrer. Nous sommes passés par Moscou, Beyrouth, Tripoli, le Soudan, la Centrafrique… Nous avons eu des ennuis à Khartoum, mais je suis tout de même rentré à Brazzaville entier. »
Dans la brousse
A l’époque, au Congo, « il n’y avait que onze médecins congolais, les autres étaient des coopérants français. Avec notamment un  de mes amis chirurgiens de l’époque, après une période de remise à niveau, nous avons commencé à gérer le service de chirurgie avec un colonel. Mais ce dernier pensait que nous n’étions pas compétents parce que « rouges » ! Nous voulions donc lui prouver le contraire et pendant un week-end de garde, nous avons opéré sans relâche. Le lundi matin, ce colonel nous a considéré comme des ennemis, quelqu’un a vendu la mèche au ministre de la Santé et j’ai été envoyé là où on envoyait les fonctionnaires récalcitrants : une sorte de « village disciplinaire », en pleine brousse. J’ai atterri à Djambala, à 500 km de tout ! Je buvais de l’eau de pluie, j’ai mangé du boa, du caïman, du singe… mais je faisais venir de l’Evian par avion pour ma fille Antoinette et mon frère m’envoyait des colis de viande et de poisson pour elle. »
de mes amis chirurgiens de l’époque, après une période de remise à niveau, nous avons commencé à gérer le service de chirurgie avec un colonel. Mais ce dernier pensait que nous n’étions pas compétents parce que « rouges » ! Nous voulions donc lui prouver le contraire et pendant un week-end de garde, nous avons opéré sans relâche. Le lundi matin, ce colonel nous a considéré comme des ennemis, quelqu’un a vendu la mèche au ministre de la Santé et j’ai été envoyé là où on envoyait les fonctionnaires récalcitrants : une sorte de « village disciplinaire », en pleine brousse. J’ai atterri à Djambala, à 500 km de tout ! Je buvais de l’eau de pluie, j’ai mangé du boa, du caïman, du singe… mais je faisais venir de l’Evian par avion pour ma fille Antoinette et mon frère m’envoyait des colis de viande et de poisson pour elle. »
Seul médecin sur place, Michel Malonga se débrouille avec les moyens du bord. « J’avais une dotation de médicaments pour six mois, je devais donc rationner fortement leur utilisation. Je n’avais pas d’oxygène, j’injectais 500 mg de nesdonal au patient, qui se mettait en apnée et je pouvais alors opérer. Avec presque rien, j’opérais des appendicectomies sous anesthésie locale, en infiltrant au fur et à mesure que je progressais, j’intervenais sur des grossesses extra-utérines, j’effectuais des ponctions lombaires en faisant des injections rachidiennes de procaïne chinoise, je réduisait des fractures… le tout avec les parents du patient dans le couloir, juste à côté, ce qui mettait la pression, car les lynchages n’étaient pas rares, malgré le respect porté aux rares médecins du pays. »
 « Mais avoir la famille à proximité avait aussi ses avantages », reconnaît le médecin : « comme je n’avais pas de banque de sang, je groupais les parents et on prélevait en fonction des besoins. La notion de « consentement éclairé » n’existait pas ! »
« Mais avoir la famille à proximité avait aussi ses avantages », reconnaît le médecin : « comme je n’avais pas de banque de sang, je groupais les parents et on prélevait en fonction des besoins. La notion de « consentement éclairé » n’existait pas ! »
« Djambala, c’était vraiment de la médecine de guerre ! Ma formation m’a bien servi pendant les deux années que j’ai passées là-bas », conclut-il.
Tradi-thérapeutes et politiciens
Outre le sous-équipement, Michel Malonga était confronté à un autre problème : la cohabitation avec les politiciens locaux, « les tradi-thérapeutes » et les sages-femmes accoucheuses. « Après une appendicectomie, j’ai été obligé de chasser un sorcier qui donnait une décoction à mon patient, alors que ce dernier ne devait rien ingurgiter. J’ai été convoqué par le maire. Finalement, on s’est mis d’accord. Je surveillais par exemple les scarifications que les sorciers faisaient sur les enfants, parce que j’avais peur du tétanos. J’ai d’ailleurs eu un cas de tétanos. L’enfant a été évacué à Brazzaville, mais il est mort à l’aéroport. »
« Finalement, je me suis mis beaucoup de monde à dos et il nous a fallu fuir dans des conditions rocambolesques. Voyant la tournure que prenaient les choses, j’ai dit à ma femme : « avance avec l’enfant, va à l’aéroport, dis au pilote de mettre l’avion en marche ». Moi, je suis sorti de l’hôpital par derrière et j’ai attrapé l’échelle de l’avion au dernier moment. La milice arrivait. Elle m’aurait lynché. »
Chômeur puis conseiller du ministre
En arrivant à Brazzaville, « on m’a mis au chômage » : « je faisais quelques aides opératoires à l’hôpital, quand mes amis m’appelaient. Mes parents sont allés voir le père du ministre de la santé. J’ai été convoqué par ce dernier et j’ai été envoyé dans le Sud du pays, pendant un an, puis j’ai travaillé en tant que conseiller du ministre, chargé du projet de développement des services de santé dans cette région.  Mais j’en ai eu assez au bout de six mois. J’ai expliqué au président de la République la situation sanitaire du pays – notamment le développement de la lèpre – mais il n’a pas eu la réaction que j’espérais. Le conseiller que je suis ensuite allé voir à Brazzaville n’a pas pris les choses plus au sérieux. J’étais déçu. »
Mais j’en ai eu assez au bout de six mois. J’ai expliqué au président de la République la situation sanitaire du pays – notamment le développement de la lèpre – mais il n’a pas eu la réaction que j’espérais. Le conseiller que je suis ensuite allé voir à Brazzaville n’a pas pris les choses plus au sérieux. J’étais déçu. »
C’est à cette époque que la carrière de Michel Malonga prend un nouveau tournant : « Un jour, un enfant qui avait inhalé une graine d’arachide est arrivé à l’hôpital mais il n’y avait pas de médecin ORL pour le prendre en charge. On devait l’envoyer dans un autre hôpital en bateau à Kinshasa, mais il est mort asphyxié avant. J’ai expliqué au ministre de la santé qu’il fallait absolument qu’au moins un médecin congolais soit spécialisé en ORL. J’ai été appuyé par mes collègues, et c’est comme cela que j’ai atterri à Montpellier, en 1978, dans le service du Professeur Yves Guerrier. »
« Mes parents ont été déçus : ils voulaient que je fasse de la chirurgie viscérale. Quand j’ai choisi l’ORL, ils m’ont demandé pourquoi… « les oreilles, c’est tellement petit », m’ont-ils dit ! », se souvient, amusé, Michel Malonga.
Face au racisme
« J’ai toujours vécu avec le racisme : déjà, à Cuba, un blanc m’avait enfermé dans un local et avait essayé de me brûler. Je l’ai étranglé jusqu’à la cyanose. C’est un ami qui m’a arrêté et celui qui m’avait agressé a été renvoyé.
J’ai aussi eu des problèmes en France, à Montpellier et en Normandie. A Montpellier, un patient s’est étonné : « je croyais que vous étiez blanc ! » Que vouliez-vous que je fasse ? J’ai appelé un de mes collègues : « Tu peux venir ? le Monsieur cherche un blanc… » Les gens, en me voyant, étaient surpris car beaucoup n’avaient jamais vu de médecin noir.
Et cela continue aujourd’hui. Récemment, un patient à la Pitié-Salpêtrière m’a expliqué que je n’étais « pas à ma place » dans cet hôpital. J’ai refusé de le recevoir. »
Mais « ce sont vraiment des choses à dépasser. Il ne faut jamais les garder en soi », explique-t-il, calmement.
Des débuts difficiles
Après trois mois de période probatoire, Michel Malonga intègre la formation en ORL. Mais, peu habitué aux méthodes françaises et toujours aussi obstiné, il éprouve quelques difficultés : « à la fin de la première année de spécialité, j’ai passé un examen comprenant 30 questions d’anatomie. A la fin de l’épreuve, il me restait 16 questions. J’ai refusé de rendre ma copie sans avoir terminé… et j’ai été renvoyé ! J’ai appris à ce moment-là qu’en France, un patron a toujours raison… Et le soir même, pour une fois, je me suis soûlé à la bière. Mais le Professeur Guerrier m’a donné une nouvelle chance : j’ai été autorisé à repasser l’examen en septembre. C’est lui qui m’a interrogé pendant toute une matinée. Il m’a permis de passer en seconde année, mais voulait m’envoyer dans un autre hôpital, à Paris, Bordeaux ou Marseille. J’ai refusé fermement : « Je suis venu pour vous, c’est avec vous que je veux travailler ! » Finalement, il s’est levé, m’a serré la main et je suis resté à Montpellier. »
Michel Malonga se lie alors d’amitié avec le fils du Pr Guerrier, Bernard. « Un jour, il m’a appelé pour l’aider au bloc, car son interne était malade. A la fin de l’opération, il m’a demandé où j’avais fait ma chirurgie, et à partir de ce moment-là, j’ai été pris dans l’équipe de chirurgie. »
Mais les ennuis de Michel Malonga ne se sont pas arrêtés pour autant : « j’ai eu des soucis avec des chefs de clinique, parce que j’étais un étranger qui mangeait le pain des Français et parce que je m’occupais des patients personnels du Professeur Guerrier ».
ORL au Congo
Ce qui ne l’empêche pas de rester à Montpellier jusqu’en 1986, complétant sa spécialité ORL par une formation en chirurgie maxillo-faciale chez l’adulte et en pédiatrie et par deux ans de neurochirurgie. « Je me suis dit : en ORL, on s’approche du cerveau, et s’il m’arrive un pépin, il faut que je puisse réagir. » Pendant ce temps, sa femme exerce en réanimation et en néonatologie, également à Montpellier.
Michel Malonga rentre ensuite au Congo, où il forme d’autres praticiens à sa spécialité. Il exerce à la fois à l’hôpital, en cabinet privé, et devient consultant pour l’Institut des jeunes sourds de Brazzaville, pendant que sa femme crée le service de néonatologie de l’hôpital de la capitale. Parallèlement, il est chargé de cours à la faculté de médecine de Bazzaville et dirige des thèses.
« En 1997, je suis revenu en France à cause de la guerre civile. J’avais peur pour ma famille et pour moi : les malades que j’avais opérés ne me reconnaissaient plus, et j’ai failli être pris pour cible. Heureusement, un jeune qui connaissait ma fille m’a reconnu et j’ai eu la vie sauve. Mais j’ai décidé de partir. »
Du tac au tac
Havane ou calva ?
Je préfère les cigares, même si un digestif, c’est bon aussi ! Lorsque j’étais étudiant, je fumais des cigares, mais j’ai arrêté quand j’ai commencé à exercer, il y a plus de 40 ans !
Django Reinhardt ou Mahler ?
J’aime toutes sortes de musiques. La musique est pour moi une sorte d’ouverture universelle. J’aime David Guetta et Jean-Michel Jarre, mais aussi Beetoven !
La musique apaise, j’en écoute toujours à la fin de mes consultations. C’est une façon de faire le vide. Sans musique, la vie est fade, morne.
J’aime la musique depuis que je suis enfant. Je me souviens que quand je suis parti à Cuba, mon frère m’a averti : « tu vas là-bas pour étudier, pas pour la musique. »
Le poulet : basquaise ou moambe ?
Les deux !
Les vacances, c’est ?
Faire le vide et penser à autre chose, vivre d’autres émotions.
Je bouge beaucoup, et j’aime particulièrement l’Europe et l’Afrique. J’aimerais aller un jour en Asie mais surtout voir les pyramides, ces monuments qui défient le temps.
A part la médecine, votre passe-temps préféré ?
J’adore la littérature, la musique et le théâtre.
Lorsque j’étais étudiant, j’animais la troupe de théâtre des étudiants congolais à Cuba, jusqu’en quatrième année de médecine – à ce moment, j’ai dû faire un choix, je ne pouvais plus mener les deux de front. Je prenais des cours tous les samedis matins à l’école de théâtre de Cuba.
Le théâtre m’a toujours passionné, et j’y vais souvent.
De Brazza à la Sarcelles
« J’estimais que l’on avait plus besoin de moi à Brazzaville. En mars 1999, étant mis à la retraite, je suis revenu à Montpellier, où j’ai exercé à la Clinique mutualiste. Mon épouse m’a suivi. Puis elle a trouvé un poste en Normandie en 2001, et cette fois, c’est moi qui l’ai suivie. Nous y sommes restés jusqu’en 2011. A l’époque, je partageais mon temps entre la Normandie et la région parisienne : Sarcelles, où se trouve mon cabinet, la Pitié-Salpêtrière, dans le service du Professeur Lamas, et le centre de santé Saint-Lazare à Paris. En 2011, nous avons quitté la Normandie et nous sommes installés en région parisienne. »
Mais pourquoi Sarcelles ? « On m’a proposé de m’associer dans le XVIe arrondissement de Paris, mais j’ai refusé. Ce que je voulais, c’est retrouver une population qui soit proche de moi, d’un point de vue moral. Je voulais être là où je serai utile à des gens venus du Tiers-Monde. On m’a expliqué que je ne deviendrai pas riche à Sarcelles, avec mes consultations à 28 euros. Mais la richesse n’est pas ce que je veux. Je veux de l’humain. Dans le XVIe arrondissement, j’aurais été confronté à des gens différents, froids, alors que je veux pouvoir avoir un contact avec mes patients, prendre le temps de leur parler. Je ne suis pas une machine, un distributeur à ordonnances ! »
Aujourd’hui, à 73 ans, ayant atteint la limite d’âge pour exercer en structure hospitalière, Michel Malonga a cessé ses activités à la Pitié-Salpêtrière et au Centre de santé Saint-Lazare à Paris.
Les médecins français, trop gâtés, trop prudents, trop spécialisés ?
De Brazzaville à Paris, l’écart est grand et il est difficile de ne pas interroger Michel Malonga sur ce qu’il pense de la médecine en France : « En tant qu’ancien chirurgien du Tiers-Monde, je pense que les médecins français sont beaucoup trop gâtés ! », affirme-t-il en riant. « Quand j’étais à Djambala, je n’avais que 4 pinces pour faire une appendicectomie, et je m’en sortais ! »
Trop gâtés, les médecins français sont peut-être aussi trop prudents : « Je trouve dommage que les jeunes n’aient pas ce goût du risque que j’avais à leur âge. Certaines interventions sont tellement codifiées… Or il faut parfois savoir oublier les codes, parce que la vie n’a pas de code ! Il faut laisser la place à l’improvisation. Les patients sont devenus procéduriers et les jeunes médecins ont peur d’être traduits devant le tribunal. Même les grands chirurgiens ont peur ! Les patients veulent 100 % de réussite, mais cela n’existe pas en médecine ! Il faut prendre des risques, on ne peut faire de médecine sans risque », insiste-t-il.
 Elargir l’horizon
Elargir l’horizon
« A Djambala, je n’avais que peu d’antibiotiques, mais il n’y avait pas plus de complications post-opératoires qu’ici. Je travaillais avec un infirmier et lorsque l’on avait fini une intervention, on stérilisait la salle au formol. Il n’y avait pas davantage de risque d’infection qu’ici. Aujourd’hui, je pense que l’on en fait trop. Il y a des résistances qui n’existaient pas avant. On ne donne pas le temps au système immunitaire de la personne d’agir. »
« Dans mon cabinet à Sarcelles, je soigne parfois les gens comme si j’étais encore dans la brousse, avec un vieux microscope et un diapason, qui me sert à faire mes diagnostics de surdité chez l’enfant ou d’otospongiose chez l’adulte. Je ne suis pas contre les dernières évolutions technologiques – j’en utilise certaines – mais leur prix me freine souvent. »
La solution pour faire sortir les jeunes médecins de cette (trop grande) prudence ? « Les envoyer faire une partie de leur formation médicale hors de France, pour voir ce qu’ils sont réellement capables de faire. L’important, c’est de sauver des vies, et lorsque l’on est dans des conditions extrêmes, on trouve toujours des ressources insoupçonnées. Je pense qu’en les envoyant ailleurs dans le monde, les jeunes médecins français acquerraient une autre vision de la médecine. »
Généraliste avant tout
Une médecine que Michel Malonga pense toujours généraliste avant tout. « Aujourd’hui, en France comme dans les autres pays développés, le spécialiste est allé tellement au fond de sa spécialité que progressivement il s’est détourné de la médecine générale. Or la médecine générale est notre socle, notre formation de base. Il faut prendre en compte le corps du patient dans son ensemble. Prenez les acouphènes : 35 maladies peuvent en être la cause. Si vous ne fouillez pas, vous ne trouverez pas l’origine du problème. »
Le médecin est donc « pour une prise en charge complète du patient. A Djambala, tout chirurgien que j’étais, je me suis retrouvé dans le rôle du généraliste. Cela explique que je continue aujourd’hui à agir comme tel. Lorsque j’étais en Normandie, je travaillais aux urgences, ce qui fait que je n’hésite pas à intervenir dans la rue quand je vois quelqu’un faire un malaise. Dans ces cas là, j’oublie que je suis ORL, je fais simplement mon travail de médecin. »
« Mais cette vision holistique n’est pas dans l’air du temps », déplore-t-il. « Un directeur de banque m’a dit un jour que je prenais trop de temps avec les malades – je passe en moyenne 15 à 20 minutes avec chacun… Mais, moi, j’estime qu’il faut parler avec les gens pour pouvoir mieux les soigner et les orienter. »
Pathologies et culture africaines
« Aujourd’hui, à Sarcelles, je vois des gens venant du Tiers-Monde – d’Afrique, du Maghreb, du Moyen-Orient – avec des problèmes d’oreille qui traînent depuis longtemps. Tout simplement parce que la pathologie de l’oreille est sous-estimée dans ces pays. Ces malades ne sont donc pas suivis. En Afrique, la majorité des pays comptent moins d’un ORL pour 1 million d’habitants. Les gens se soignent avec des plantes, dont certaines ont des effets négatifs et peuvent même entraîner des sténoses du conduit auditif. Lorsqu’ils arrivent à la capitale, ils sont en général au stade terminal de la maladie, avec des complications inévitables. J’ai vu par exemple des patients arriver avec un nerf facial en lambeaux… »
Quant à l’appareillage auditif, « c’est un luxe au Congo. Un seul de nos universitaires est appareillé. Les jeunes sourds sont livrés à eux-mêmes. Or la prescription d’appareillage n’est pas un luxe : la surdité est un déficit sensoriel et les audioprothèses sont des aides indispensables. Ce qui est du luxe, c’est leur prix. Après avoir visité un usine de fabrication d’aides auditives, j’ai compris pourquoi elles sont vendues si cher. Mais il reste que des appareils neufs sont tout simplement inaccessibles dans les pays du Tiers-Monde. »
C’est pourquoi Michel Malonga « récupère de vieux appareils en France ». Avis aux âmes généreuses, « n’hésitez pas à me contacter si vous avez des appareils usagés ! » lance le médecin.


« Cet enfant avait une tumeur rare : un tératome rétro-auriculaire. Je l’ai opéré. Il n’y a eu que deux cas semblables qui ont fait l’objet de publications dans le monde. »

« Cette photo a été prise en 1992. Cet homme avait un goitre. Il était marginalisé dans son village, parce que les gens pensaient qu’il avait mangé un autre homme, qui s’était accroché dans sa gorge… Je l’ai opéré. »


« Cet enfant avait aspiré une pointe, qui s’était coincée dans ses bronches. Lorsqu’il est arrivé à l’hôpital de Brazzaville, le pédiatre et moi, qui n’étions ni l’un ni l’autre chirurgien thoracique, n’avons pas eu le choix : il fallait l’opérer ! Et nous avons réussi. »